Historien de renom, homme de radio et de télévision, Franck Ferrand vient de préfacer un album publié à l’archipel. Ce « livre du souvenir », superbement illustré, parcourt les 70 ans de règne d’Élizabeth II. Nous lui avons demandé son sentiment sur la souveraineté qui demeurera l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire britannique.
Dynastie : On a parlé de nouvelle ère élisabéthaine. Qu’en pensez-vous ? Quelle marque le règne d’Élisabeth II laissera-t-il dans l’histoire ?

Franck Ferrand : Il n’a pas dû être facile, il y a soixante-dix ans, pour la fille aînée de George VI, de monter sur le trône d’Angleterre avec ce prénom qu’aucune souveraine n’avait plus porté depuis la Reine Vierge – cette rousse Élisabeth Tudor – à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. L’« ère élisabéthaine » faisait office, en quelque sorte, d’âge d’or pour la monarchie britannique en général, et tout spécialement aux yeux de la dernière dynastie, celle des Hanovre, ancrée dans l’anglicanisme. Par sa force d’âme, sa dignité jamais prise en défaut, le charisme dont elle a su faire preuve et, finalement, par sa longévité aussi, l’actuelle souveraine a su se montrer à la hauteur du prénom qu’elle porte, et rendre possible, sans ridicule aucun, cette appellation souvent reprise de « nouvelle ère élisabéthaine ». Force est néanmoins de souligner une différence très notable entre les deux règnes : celui de la première Élisabeth aura marqué l’accession de la Grande-Bretagne au rang de puissance mondiale ; celui de la deuxième aura vu cette puissance décliner fortement. L’on montait, au tournant du XVIIe siècle ; au tournant du XXIe, on redescend.
D. : Comment placeriez-vous Élisabeth II dans la longue histoire britannique ? À quels autres souverains la comparer ?
F F. : Elle-même s’inscrit assez volontiers dans le souvenir de son aïeule, la reine Victoria. J’ai toujours été frappé par les éléments de ressemblance entre ces deux femmes au fort tempérament. Je ne serais du reste pas étonné outre mesure que le parallélisme se prolonge dans les générations suivantes ; ainsi, le prince Charles, quand viendra son tour, pourrait devenir une version contemporaine d’Édouard VII et son propre fils, William, inscrire ses pas dans ceux de George V… L’autre reine d’Angleterre à laquelle il serait intéressant de comparer Élisabeth II, c’est la reine Anne, au début du XVIIIe siècle, dont elle a d’ailleurs donné le prénom à sa fille, la princesse royale. Anne était droite et forte, intelligente mais réservée, essentiellement animée par le respect des traditions ; elle n’avait pas, il est vrai, la solidité physique de sa lointaine héritière, puisqu’elle a quitté ce monde à l’âge de 49 ans.
D. : La reine a effectué dans notre pays de nombreux voyages ; que pouvez-vous nous dire de son « idée » de la France, en particulier de ses séjours à Versailles, que vous connaissez si bien ?
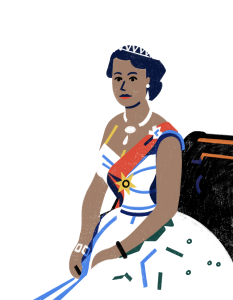
F F. : Dans leur enfance, les princesses Élisabeth et Margaret ont bénéficié des leçons d’une gouvernante, Marion Crawford, qui les a familiarisées à la langue de Molière et leur a donné le goût de la culture continentale. Il y aurait une jolie chronique à écrire, des visites – officielles, mais aussi privées – de la reine en France, depuis trois quarts de siècle. Je me rappelle notamment, pour ma part, les visites d’État de 2004 et 2014 ; lors de cette dernière, j’ai d’ailleurs eu l’honneur d’être présenté à Sa Majesté, ce qui m’a beaucoup impressionné, ai-je besoin de le préciser ? Nombreux sont, en France, les châteaux, les haras, les restaurants, les entreprises d’excellence qui ont reçu la visite de la reine et du prince Philip à l’occasion d’un de leurs voyages ; et il n’est pas rare qu’on en exhibe les photos ou les autographes, encadrés comme autant de titres de gloire… De toutes ces occasions grandes et petites, c’est évidemment la première visite d’État, en 1957, à l’invitation du président René Coty, qui a le plus marqué les mémoires ; le grand déjeuner de gala dans la galerie des Glaces, au château de Versailles, suivi d’une représentation à l’Opéra royal, alors tout juste restauré, avait laissé aux Français de la génération de nos grands-parents un souvenir impérissable.
D. : Entre Brexit et velléités d’indépendance de l’Écosse, communautarismes religieux, scandales familiaux, comment l’institution monarchique va-t-elle survivre à la disparition d’Élisabeth ?
F F. : Pendant ce si long règne, rien n’aura été épargné à Élisabeth – c’est Le moins que l’on puisse dire ! Le grand album de Catherine Ryan, traduit par les soins de L’Archipel, dresse un catalogue impressionnant des épreuves, des embûches, des défis constamment jetés en travers du chemin de la souveraine, depuis son couronnement – et même avant, pour tout dire… Les spectateurs de la série télévisée The Crown, au-delà de quelques aspects romancés, ont pu, eux aussi, en prendre la mesure. Il me paraît juste de dire que cette femme d’exception a tout surmonté bravement, noblement, sans jamais se plaindre et sans rien expliquer – « Never explain, never complain » –, selon le viatique proposé par Victoria au prince de Galles, le futur Édouard VII… Les souverains d’Angleterre ne font pas – ne font plus – de politique ; on ne sait donc pas très officiellement ce qu’Élisabeth a pensé du Brexit ; pour ce qui est de l’Écosse, je soupçonne les sécessionnistes de n’avoir pas voulu infliger à cette vieille dame un affront trop direct… Il est probable qu’après son départ – le plus tard possible – la Monarchie devra s’adapter à un monde dont Élisabeth II aura été l’ultime représentante, et composer avec des réalités de moins en moins favorables.
Philippe Delorme










